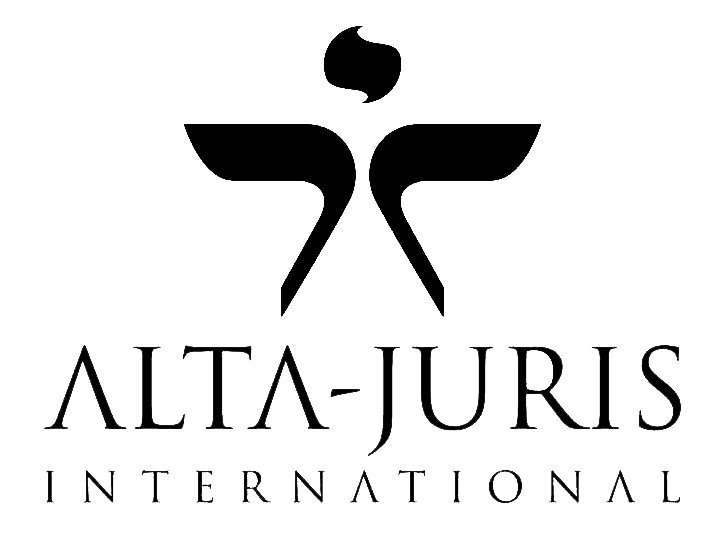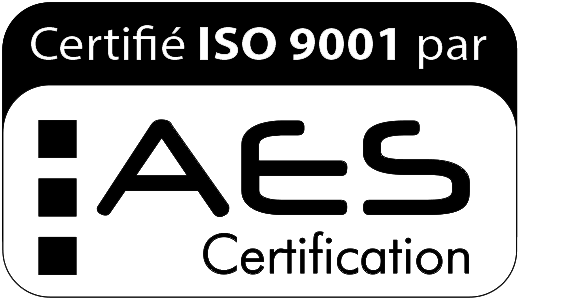Cour de cassation, chambre commerciale, 2 juillet 2025, n°24-16.590, Publié au Bulletin
Lorsque l’on est victime d’une fraude bancaire, la panique prend souvent le dessus. Les scénarios sont multiples et évoluent chaque jour, mais l’issue est bien souvent la même : un préjudice financier et moral à sa victime.
Les juridictions sont régulièrement saisies de demandes dirigées par les consommateurs victimes à l’encontre de leur établissement de crédit sur le fondement des articles L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier afin d’obtenir le remboursement des sommes frauduleusement retirées de leur compte de chèques.
Avant toute action au fond, faisons le point sur les délais pour agir de la victime d’une fraude bancaire.
Un double délai est instauré à la fois par l’article 2224 du Code civil et par l’article L.133-24 alinéa 1er du Code monétaire et financier.
Concernant les clients professionnels, l’alinéa 2 de cet article précise que « les parties peuvent convenir d’un délai distinct ». Il est donc important de relire les conditions générales et particulières de votre compte.
1. Le délai de forclusion de l’article L.133-24 du Code monétaire et financier
L’article L.133-24 du Code monétaire et financier fixe le principe suivant : le consommateur doit signaler, sans tarder, à sa banque et au plus tard dans un délai de treize mois toute opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.
La jurisprudence s’est montrée très hésitante sur la portée de ce délai. Certaines juridictions considéraient que ce délai, qui est un délai de forclusion, imposait au consommateur d’agir devant la justice dans ce très court délai, à peine d’irrecevabilité de son action[1]. D’autres ont pris le parti de considérer que ce délai ne constituait qu’une information à destination de la banque [2].
Par un arrêt très attendu et très commenté, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a finalement clarifié le régime par un attendu de principe :
« Aux termes de [l’article L.133-24 du Code monétaire et financier], l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [W], l’arrêt, après avoir constaté que celui-ci avait, le 7 mars 2019, formé opposition aux deux virements effectués à partir de son compte les 5 et 6 mars 2019 en déclarant ne pas en être à l’origine, retient que l’assignation en paiement ayant été délivrée le 21 décembre 2021, soit plus de treize mois plus tard, l’action encourt la forclusion.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que M. [W] avait signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui l’autorisait à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun, la cour d’appel a violé l’article susvisé. »
Le délai de treize mois concerne uniquement le signalement de l’opération à la banque et non le délai pour saisir la justice.
L’enjeu est de taille : pour un consommateur victime d’une opération frauduleuse, le respect du délai de signalement de treize mois permet de préserver son droit d’agir.
Vigilance et réactivité sont de mises : ce délai est impératif et court à compter de la date de débit de l’opération, sauf exceptions.
Dès que le client a eu connaissance d’une opération non autorisée ou mal réalisée, celui-ci doit se ménager la preuve d’avoir effectivement informé sa banque dans le délai susvisé.
Si, en principe, aucun formalisme n’est requis pour le signalement en question, un écrit doit être privilégié. La banque peut également imposer un mode de signalement qui lui est propre (un formulaire par exemple), tant que celui-ci n’est pas trop contraignant. Le signalement en question doit en tout état de cause être suffisamment précis pour identifier le compte concerné, les opérations litigieuses et la victime.
2. Le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil
Si la victime a respecté le délai de forclusion, il peut, en cas de refus de son établissement bancaire de rembourser les sommes frauduleusement prélevées, engager une action en justice dans le délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil.
Selon cet article, l’action en justice doit être introduite dans un délai de 5 ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
À ce jour, la Cour de cassation est restée silencieuse sur le point de départ précis de ce délai.
Plusieurs hypothèses sont possibles :
- La date de l’opération non autorisée ou mal réalisée pour coïncider avec le point de départ de la forclusion ;
- La date de signalement de l’opération non autorisée ou mal réalisée ;
- La date à laquelle le client a été avisé du refus de son établissement bancaire de procéder au remboursement des sommes prévu l’article L.133-18 du Code monétaire et financier.
La prudence veut que soit privilégiée la première hypothèse, bien qu’un report théorique à la date de signalement semble admis par la doctrine.
Le régime juridique de la fraude bancaire continue de soulever de nombreuses interrogations et de faire couler beaucoup d’encres parmi les auteurs et les praticiens du droit.
Si vous êtes concerné(e) par une fraude bancaire ou vous avez des doutes sur vos droits, contactez dès à présent notre cabinet à Saint-Brieuc : notre équipe d’avocats et notre pôle commercial sont à votre écoute pour vous accompagner et défendre vos intérêts.
[1] Cour d’appel de Douai, 21 mars 2024, RG n°23/02376
Ordonnance du JME – Tribunal judiciaire de Paris, 13 juin 2024, RG n°24/01398
[2] Cour d’appel de Paris, 10 mai 2023, RG n°21/07764
Ordonnance du JME – Tribunal judiciaire de Paris 10 avril 2025, RG n°24/07337