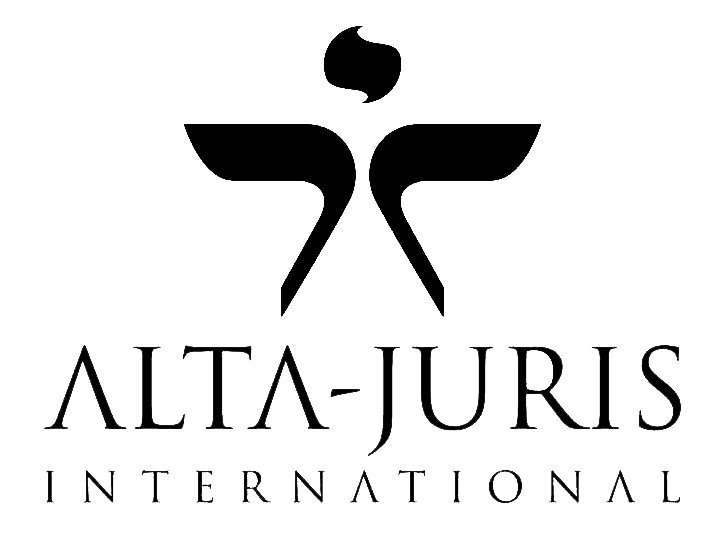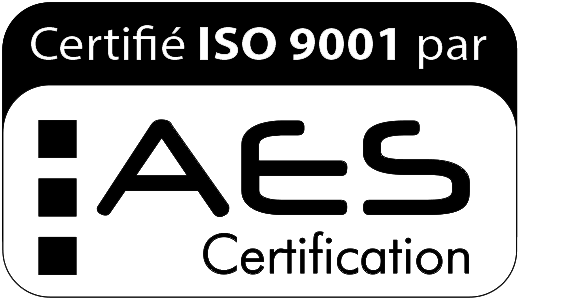Par deux arrêts rendus le 10 septembre 2025, la Chambre Sociale de la Cour de cassation opère des revirements de sa jurisprudence en matière de congés payés afin de s’aligner sur le droit européen.
1ère affaire : différence entre le congé payé et l’arrêt maladie
Dans la première affaire (n°23-22.732)[1], l’employeur reprochait à la Cour d’appel de PARIS d’avoir jugé qu’il convenait de ne pas décompter, en congés payés, les jours d’arrêts maladie de la salariée tombant sur ses congés.
Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait que le salarié tombant malade au cours de ses congés payés ne pouvait exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’avait pas pu bénéficier du fait de son arrêt de travail.
Selon la Cour, l’employeur s’était en effet acquitté de son obligation[2].
Cependant, il y a plusieurs années, la Cour de Justice de l’Union Européenne a posé le principe que le droit au congé annuel payé constituait un principe essentiel du droit social de l’Union[3] et que la finalité du droit au congé annuel payé, qui est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs, diffère de celle du droit au congé de maladie, qui est accordé au travailleur afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie[4].
Sur le fondement de ces principes et au visa de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, la Cour de Justice de l’Union Européenne a invalidé, par un arrêt du 21 juin 2012, des dispositions nationales prévoyant qu’un travailleur en incapacité de travail survenue pendant la période de congés annuels payés n’avait pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail.[5]
Interprétant l’article L.3141-3 du code du travail[6] à la lumière de la directive 2003/88/CE et des arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne, la Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel de Paris avait fait une exacte application de la loi en retenant que la salariée, qui avait fait l’objet, durant ses périodes de congés payés, d’arrêts de travail pour cause de maladie notifiés à l’employeur, pouvait prétendre au report des jours de congés correspondants, lesquels ne pouvaient dès lors être imputés sur son solde de congés payés.
Par ce revirement, une différence de nature est donc introduite entre le congé payé, période de détente, de repos et de loisirs et l’arrêt maladie dont l’objet est de permettre le rétablissement du salarié.
- Le salarié qui tombe malade pendant ses congés peut désormais solliciter le report des jours sur lesquels il est tombé malade.
- A noter toutefois : pour pouvoir bénéficier du report de ses jours de congés, le salarié doit impérativement notifier son arrêt de travail à l’employeur.
- Se pose également, dans ce cas de figure, la question de l’obligation d’information instituée par la loi DDADUE du 24 avril 2024 à L.3141-19-3 du code du travail. Dans une telle situation, le Ministère du Travail[7] préconise à l’employeur d’informer le salarié, à son retour, du nombre de jours de congés payés dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces congés pourront être pris.
2ème affaire : congés payés et heures supplémentaires
Dans la seconde affaire (n°23-22.55)[1], des salariés ont reproché à la Cour d’appel de VERSAILLES d’avoir déduit, pour le calcul des heures supplémentaires réalisées sur la semaine, leurs absences liées à des congés payés.
C’est cette fois au visa de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne[2] et l’article L.3121-28 du code du travail[3] que la Cour de cassation a rendu son arrêt.
Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait que les jours de congés payés ne pouvaient être pris en compte pour la détermination des heures supplémentaires[4].
Reprenant le principe posé par la Cour de Justice de l’Union Européenne selon lequel le droit au congé annuel payé constituait un principe essentiel du droit social de l’Union[5] et y ajoutant que celui selon lequel le droit au congé annuel et celui à l’obtention d’un paiement à ce titre constituent deux volets d’un droit unique au sens de la directive 2003/88/CE, la Cour de Cassation rappelle que la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé, en 2006 et 2018, que l’obtention de la rémunération ordinaire durant la période de congé annuel payé visait à permettre au travailleur de prendre effectivement les jours de congé auxquels il a droit. [6] [7]
Dorénavant, il convient donc d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L.3121-28 du code du travail, en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif, les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires d’un salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail.
- Dans le cadre d’un décompte de la durée du travail sur la semaine, les périodes de congés payés sont assimilées à du temps de travail effectif pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
- Cette jurisprudence ne partirait-elle pas du postulat (à notre avis erroné) que le salarié qui pose des congés payés sur une partie d’une semaine donnée devra effectuer des heures supplémentaires sur les jours effectivement travaillés pour « rattraper le temps perdu » ?
- La solution retenue se limite toutefois aux salariés soumis à un décompte hebdomadaire de leur durée de travail, excluant, pour le moment, les autres modes de décompte du temps de travail.
Cette décision ne risque-t-elle pas de créer une différence de traitement à l’égard des salariés dont la durée de travail est fixée annuellement ?
La suite du feuilleton dans les prochains épisodes !
Dans l’attente, le pôle Travail reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
[1] Cass. Soc. 10 septembre 2025, n°23-22.732
[2] Cass. Soc. 4 décembre 1996, n°93-44.907
[3] CJUE, 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16, point 80
[4] CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C-350/06 et C-520/06, point 25, CJUE, 10 septembre 2009, Perada, C-277/08, point 21
[5] CJUE, 21 juin 2012, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), C-78/11
[6] « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. »
[7] Les congés payés | Travail-emploi.gouv.fr | Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités, des Familles et de l’Autonomie
[1] Cass. Soc. 10 septembre 2025, n°23-14.455
[2] « tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés »
[3] « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
[4] Cass. Soc., 4 avril 2012, pourvoi n° 10-10.701
[5] Voir infra note 3
[6] CJUE, 16 mars 2006, Robinson-Steele e.a., C-131/04 et C-257/04, point 49
[7] CJUE, 13 décembre 2018, Hein, C-385/17, point 44